Etiquettes : Algérie, France, immigration, Maher Mezahi,
Dans notre série de lettres de journalistes africains, Maher Mezahi revient sur les raisons qui l’ont poussé à quitter la France et à retourner en Algérie, d’où est originaire sa famille.
Dans chaque famille d’immigrants, il y a une personne qui est trop critique à l’égard de tout ce qui concerne son pays d’origine.
Lors d’une discussion en famille, vous pouvez mentionner un fruit qui pousse chez vous et ils révéleront que son prix a plus que triplé au cours de la dernière année.
Des nouvelles arriveront concernant une nièce ou un neveu qui a obtenu son diplôme d’études secondaires et ils déploreront que tout cela n’a servi à rien parce que la qualité de l’éducation est chaotique.
En grandissant, mon père était ce membre de la famille et donc mes voyages en Algérie – je vivais au Canada à l’époque – étaient teintés de remarques amères et d’une forte paranoïa.
J’ai supposé que son pessimisme provenait de la culpabilité d’avoir abandonné tout ce qu’il savait, et ses critiques semblaient être une manière de rationaliser son départ, principalement envers lui-même.
En conséquence, je ne pouvais pas vraiment me forger mon propre jugement sur la vie en Algérie jusqu’à ce que je commence à y aller seul en tant que jeune adulte.
À cette époque, je suis tombé follement amoureux du football africain et j’en suis arrivé à la conclusion que la seule façon de poursuivre correctement une carrière dans le journalisme de football était de « retourner » en Algérie.
On a beaucoup écrit sur « l’immigration inversée » et sur la façon dont les enfants d’immigrés de première génération « retournent » dans leur pays d’origine pour redécouvrir des sagesses perdues, se rapprocher de leur famille élargie et réparer les crises d’identité.
Ils racontent souvent des histoires réconfortantes, mais les générations plus âgées sont plus cyniques et font des remarques déplacées telles que : « Attendez qu’ils aient à remplir des formalités administratives auprès d’une agence gouvernementale. »
Je me souviens encore très bien d’un dîner dans notre salon familial au Canada, un soir, alors que j’insistais sur le fait qu’il était temps pour moi de déménager à Alger.
« Je lui donne deux ans », a déclaré mon frère aîné avec un sourire aux lèvres.
« Deux ans ? Plutôt deux mois », rétorqua mon père.
Les paris sur combien de temps je pourrais rester en Algérie sont devenus un jeu auquel même la famille élargie allait participer au cours des mois suivants.
J’ai fini par durer six ans.
Les premières années à Alger ont été extrêmement passionnantes.
Il y a eu un afflux de journalistes, de jeunes professionnels et d’entrepreneurs de la diaspora arrivés à peu près en même temps que moi, au milieu des années 2010.
L’économie du pays était en plein essor depuis cinq ans et les possibilités semblaient infinies.
Les écoles d’anglais poussaient partout dans la capitale comme des champignons sauvages.
L’Algérie venait tout juste de sortir d’un parcours inspirant à la Coupe du Monde de la FIFA 2014, et les performances scintillantes de ses footballeurs internationaux comme Yacine Brahimi et Riyad Mahrez ont permis de braquer les projecteurs sur notre football.
Pour un journaliste qui enseignait l’anglais comme langue seconde en parallèle, c’était une solution idéale.
Mais quiconque a la chance de devenir un adulte à part entière sait qu’un jour, nous deviendrons tous comme nos parents.
Et même si je ne pense pas déplorer régulièrement les problèmes de l’Algérie, j’ai fini par trouver quelques excuses pour partir il y a un an et demi.
Pour moi, c’était une combinaison de restrictions de voyage étouffantes dues à la pandémie de Covid-19 (les frontières algériennes ont été fermées pendant près de deux ans) et d’un recul des libertés civiles qui ont rendu la pratique du journalisme beaucoup plus difficile.
Je suis aussi arrivé à un point de ma vie où j’avais envie de « vivre quelque chose de différent » et cela m’a amené à déménager à Marseille, dans le sud de la France.
Avec son architecture époustouflante, ses pâtisseries au beurre et son temps ensoleillé, les plaisirs du monde ne manquent évidemment pas, mais j’ai très vite compris que ce n’était pas pour moi.
Je pense que la principale raison pour laquelle je ne me sens pas à ma place est que je ne fais pas de reportage sur le football africain sur le terrain.
Rien au monde ne peut remplacer le sentiment de savoir que vous avez trouvé votre véritable vocation et de réaliser que vous contribuez, même de manière modeste, au domaine de votre choix.
Mais en plus de la joie que me procurent le journalisme et le storytelling, d’autres choses plus triviales me font reculer.
Il s’agit d’appeler un taxi (encore abordable comme moyen de transport quotidien en Algérie), de se faire un nouvel ami pendant son trajet et de croquer dans les petites sardines pêchées au large des côtes.
J’ai réalisé qu’au cours du voyage de la vie, si vous trouvez le bonheur dans les banalités de la vie quotidienne, c’est généralement un bon endroit pour vous arrêter et planter votre tente.
Et donc maintenant, je me prépare à « immigrer à l’envers » pour la deuxième fois, et cela a été un moment de réflexion.
J’ai comparé l’excitation et la sentimentalité de mon premier déménagement en 2016 à ce que je ressens aujourd’hui.
Je ne suis pas aussi excité qu’à l’époque, il y a beaucoup moins à découvrir et la nouveauté s’est complètement dissipée.
Je suis déjà fatigué de la bureaucratie implacable, du système judiciaire précaire et des difficultés à trouver des soins de santé spécialisés en cas de besoin.
Pourtant, la liste des inconvénients s’estompe lorsque je réalise que je rentre chez moi pour faire ce que j’aime le plus dans l’endroit que j’aime le plus.
Et c’est un sentiment que j’espère que tout le monde ressent au moins une fois dans sa vie.
#France #Algérie #Immigration

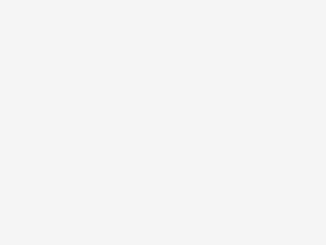
Soyez le premier à commenter